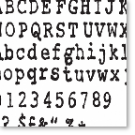IL CAMPANELLO a Ginevra
about me > TITOLI > 2023
Fotografie di Alex Gerenton


Opéra de Chambre de Genève
8, 12, 13 juillet 2023 à 20h30
Salle de l'Alhambra
GAETANO DONIZETTI (1797-1848)
IL CAMPANELLO (1836)
Direction musicale Franco Trinca
Mise en scène, conception décors et costumes Francesco Bellotto
Lumières Samuele D'Amico
Don Annibale Pistacchio Michele Govi
Serafina Bianca Tognocchi
Enrico Andrei Maksimov
Madama Rosa Mashal Arman
Spiridione Paul Belmonte
La sartina Mirella Mira Alkhovik
Il poeta Frédéric Frédéric Caussy
Il sergente Guglielmi Etienne Prost
L'ORCHESTRE DE CHAMBRE DE GENEVE
TRAILER

La farce est un genre théâtral aujourd’hui disparu. Eduardo le savait aussi, qui en mettant en scène les farces de son père, Eduardo Scarpetta, faisait presque toujours des « adaptations libres », admettant implicitement l’impossibilité de perpétuer littéralement – à l’ère du moderne « théâtre de mise en scène » – les méthodes, les contenus et l’efficacité de ce répertoire, au moins aussi ancien que la commedia dell’arte. La farce était une forme théâtrale ancienne et simple, très populaire : elle reposait sur des intrigues schématiques, des allusions au monde contemporain, des parodies, des petites tromperies, un jeu chargé, une posture frontale des acteurs, des rôles principaux confiés à de véritables « vedettes » capables de ravir les spectateurs. Dans les années 1810, à l’imitation du Vaudeville français, les plus grands compositeurs – se conformant aux demandes du public – se mettent à écrire des partitions courtes et très amusantes pour des scènes de théâtre d’opéra, confiées à des chanteurs « drôles » au talent extraordinaire. Au cours de ces années, la farce « parlée » est également devenue une « farce musicale ». Donizetti en a écrit au moins une douzaine, presque toutes pour Naples. Voilà : à Naples, dans les années de Donizetti, la farce a peut-être atteint son plus grand succès. Une anecdote pour aider à comprendre le potentiel de ce type de spectacle : en mai 1836 à Naples on craignait l’arrivée de l’épidémie de choléra du nord de l’Italie. Les théâtres royaux ont été fermés, tandis que les théâtres indépendants essayaient de survivre d’une manière ou d’une autre. Mais le public avait peur de la contagion et donc le Teatro Nuovo, sans une programmation d’attrait, était sur le point d’échouer avec de nombreux artistes qui ne savaient plus comment survivre. Le célèbre Donizetti décida donc en toute hâte d’écrire le livret et la musique d’une nouvelle farce, La Cloche de l’Apothicaire, à offrir à ses amis du Teatro Nuovo. Le public, attiré par le nom et la générosité du Maestro, vient en nombre : le succès est tel que la fortune du Théâtre se redresse, échappant à la faillite.
Mais – comme je l’ai dit – la farce (musicale et autre) n’est plus à la mode aujourd’hui : à la fin du XIXe siècle, elle avait presque disparue, même dans la patrie de Naples. Le dernier éclair de ce genre a eu lieu entre les années quarante et le début des années soixante du XXe siècle, lorsque la cinématographie italienne a commencé à exploiter avec grand succès les histoires anciennes et les anciens masques d’acteurs brillants tels que – par exemple – Nino Taranto, Peppino De Filippo, Tina Pica, Pietro De Vico et bien sûr Totò. Ici : J’ai donc voulu penser à La Cloche comme une expression de ce monde, de cette tradition. Puisque le décor pour ceux qui mettent en scène est le premier outil pour trouver des liens efficaces entre le public au théâtre et l’action sur scène, j’ai voulu situer l’action à l’époque de la farce cinématographique, dans l’imaginaire des Totò et des De Sica. En un mot : j’ai pris la dernière image d’une longue tradition, cette sorte d’instant figé avant l’oubli, car c’est la seule imagerie qui nous soit parvenue, le seul décor qui – ne serait-ce qu’au premier coup d’œil – peut immédiatement évoquer au public d’aujourd’hui les nuances, les climats, le style de ce monde perdu.
C’était donc le point de départ. En montant le spectacle et en portant cette approche, j’ai donc demandé aux interprètes de rappeler l’âge d’or de la farce, également dans le style de jeu. Pour une fois, je voulais trahir Stanislavskij, Antoine et être un anti-metteur en scène : c’est-à-dire oublier les intellectualismes, les sous-textes et les métapsychologies. Jouer sous les feux de la rampe ? Devant le public ? Avec des gestes chargés ? Avec des costumes, du maquillage et des perruques de personnages ?
Oui : parce que ce que je voudrais montrer au public genevois, c’est la voie d’une pratique théâtrale qui n’est plus connue. Et ainsi honorer le son, l’élégance, le charme et la poésie d’une noble langue perdue.